Toujours des ouvriers, ouvrier pour toujours
Diverses conséquences des plus récents progrès de l’efficacité économique sont examinées : la mentalité des jeunes générations, l’adaptation à ces nouvelles conditions où les hommes ne sont plus que les parasites des machines qui assurent le fonctionnement de l’organisation sociale.
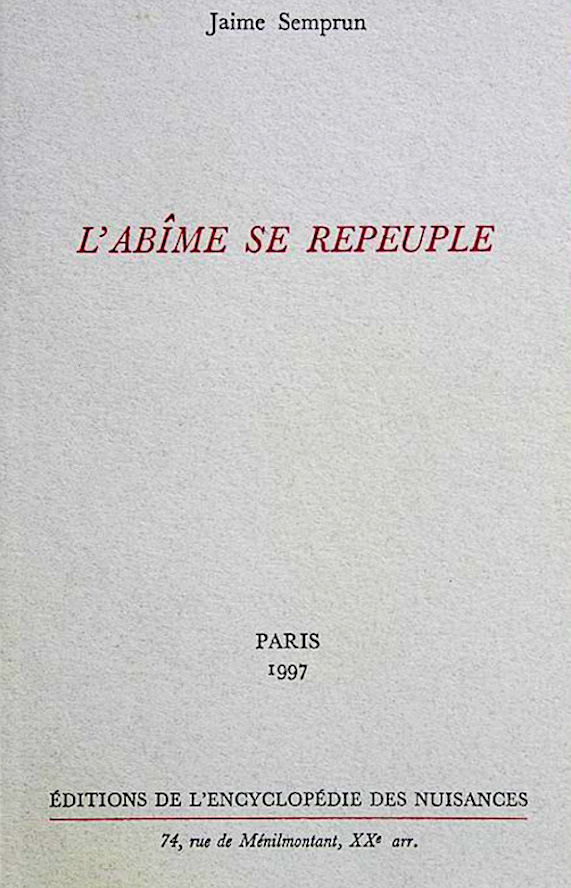
« Il en faudra toujours, des ouvriers ! ». Mon père était outré par mes propos. Comme si c’était sa propre mort que je souhaitais. Plus d’ouvriers ! je l’espérais. Il ne comprenait pas. C’était la seule identité qu’il possédait et je voulais l’en démunir. Son propre fils ! Pourtant, il ne l’était plus, ouvrier. Au moment où je me soumets à la vindicte, il travaillait comme gardien de la salle des fêtes municipale de la petite ville communiste à l’est de Grenoble où mes parents s’étaient exilés après la fermeture de l’usine de Givet, dans les Ardennes. Mon père y avait travaillé pendant 27 ans et demi (il y tenait à cette précision, ce semestre !). Il ne l’était plus, mais il le serait toujours : ouvrier. J’étais donc un fils ingrat. J’étais dans l’autre camp. Je ne voyais donc aucune dignité dans la condition d’ouvrier ! Je m’expliquais mal. J’étais trop jeune, j’avais des intuitions et des visions de poète et j’essayais de les traduire en langage politique. J’essayais. Je parlais d’espoir ! Je le balbutiais. Je voulais que plus jamais aucun homme n’ait à subir ce que décrit Robert Linhart dans L’Établi et dont Bertrand Poirot-Delpech disait dans le journal Le Monde en 1978 : « Je n’ai rien lu de plus atroce, de plus accusateur, dans la nudité, depuis Une journée d’Ivan Denissovitch, de Soljenitsyne. Avec cette circonstance, que chacun peut trouver aggravante ou pas, que cela ne se passe pas en Sibérie, mais sous nos fenêtres, ni vu ni connu, à jet de boulon. » Oui, il fut une époque où ou pouvait lire ça dans ce journal. Je rêvais encore que plus aucun homme n’ait à travailler chez Toyota : L’Usine du désespoir que décrit Kamata Satoshi. C’est de ce genre d’ouvriers que je ne voulais plus. Mon père et moi, nous ne parlions pas du même ouvrier. Pourtant, nous savions tous deux de quoi nous parlions. Lui plus que moi, nous avions expérimenté la condition d’ouvrier. Certes, nous n’avions ni l’un ni l’autre travaillé sur une chaîne de montage. Nous ne savions pas ce que c’était de couler. Nous n’avions jamais eu sur le dos un sous-prolétaire surveillant et chronométrant chacun de nos gestes. Mais, nous avions vécu dans notre chair l’aliénation qu’engendre la division du travail. Et, nous en étions conscients. Mon père quand il était ouvrier avait travaillé à l’atelier de préparation de la colle de son usine de fabrication d ‘adhésifs ; conducteur de malaxeur, tel était l’intitulé de son poste. Je l’avais su car je n’avais plus voulu plus, à partir du collège, renseigner la fiche de mon père d’un simple « ouvrier spécialisé » quand les filles et les fils de techniciens, de cadres ou d’employés des services attribuaient des noms de métiers à leurs parents et non de simples catégories socio-professionnelles. Assistante de direction, c’était mieux que « profession intermédiaire », professeur de Lettres mieux que « fonctionnaire de l’Éducation nationale », et conducteur de malaxeur mieux que OS. Je n’avais jamais entendu le mot « malaxeur » et je n’osai demander quelque explication. J’étais un peu anxieux à l’idée que le professeur me proposât de faire un exposé sur le travail de mon père. Qu’en savais-je ? J’avais seulement compris que l’atelier où mon père passait huit heures à manipuler des produits toxiques et inflammables comme le toluène, était un endroit dangereux. Il y avait eu trois morts. « Avec zéro litre d’essence ! » comme s’exclamait mon père avec une certaine fierté. Il était en première ligne, exposé au danger. Un simple frottement et les électrons s’étaient mis en mouvement avant d’enflammer les hydrocarbures. Tous les six mois, mon père devait faire une analyse de sang car les risques de maladie professionnels comme le benzolisme étaient élevés. Quant à moi, la première fois que je mis les chaussures de sécurité, ce fut pour me jucher – c’était pourtant interdit et les ouvriers délégués CHSCT et même l’ingénieur ne se privaient pas de nous le rappeler – en haut d’un tas de cuivre de seconde main où je triais tôle, tube, fils, divers objets manufacturés comme des seaux à champagne qui faisaient de très chouettes pots pour les plantes. « Un travail du Moyen-Âge » comme disaient les ouvriers qui me voyaient sur mon tas, dépités de constater que l’usine en étaient à faire des économie de bouts de chandelle en achetant des rebuts plutôt que de la matière première. Je travaillai en tout un peu plus d’un semestre à l’usine, celui qui manquait à mon père pour qu’il pût se targuer d’avoir été ouvrier pendant 28 ans. J’eus un second poste dans une usine textile où l’on fabriquait du fil de viscose. J’en relate la légende héroïque ici.
Mon père qui avait suivi des formations théoriques de la CGT et du Parti communiste et moi-même grâce à mes lectures connaissions l’abstrait et le concret de la lutte des classes, de l’exploitation et du fétichisme de la marchandise. Ce qui nous séparait était la doctrine du Parti communiste que je peux résumer en un mot : l’ouvriérisme. Il était bien d’être ouvrier parce que l’ouvrier – avec une conscience de classe – avait un rôle historique à jouer. Sa mission était de renverser le monde cul par-dessus tête pour le remettre à l’endroit, processus autrement appelé « faire la Révolution ». Et s’il n’y avait plus d’ouvriers qui la ferait la Révolution ? Et si je souhaitais qu’il n’y ait plus d’ouvriers, c’est donc parce que je ne souhaitais pas que la révolution eut lieu ! Le Parti communiste pour des raisons de stratégie avaient confondu ouvrier et prolétariat. Grâce au Parti communiste mon père croyait en sa dignité. Il pouvait être fier de défiler le 1er Mai. La formation théorique de mon père s’arrêtait aux grands principes du marxisme-léninisme. De mon côté, j’étais allé plus loin, en lisant Günther Anders, Guy Debord et Jaime Semprun. J’étais allé (trop ?) loin en admirant John Ludd, Boris Savinkov, et même Theodore Kaczynski, surnommé Unabomber. Mon père prétendait qu’un ouvrier devait d’abord bien faire son travail, ce n’était qu’ensuite qu’il avait le droit de revendiquer. Malgré l’exploitation, l’aliénation, la division du travail, l’ouvrier devait être consciencieux parce qu’il créait ainsi les conditions de sa future émancipation. Moi, je croyais au péché originel. Il y avait de la mystique, du mythe dans mon engagement. Il fallait détruire d’abord. Il n’y aurait plus d’ouvriers parce qu’il fallait réduire en cendre et en poussière le monde industriel. Annihiler le fétichisme de la marchandise en annihilant la marchandise. Pourtant, j’ai conscience que malgré tout, il fait mieux vivre pour un ouvrier en 2021 qu’en 1850. Si j’étais né en 1870, je ne serais pas là en train de réfléchir et d’écrire. Je serais peut-être mort depuis longtemps. Les conditions de vie d’un ouvrier occidental au XXIe siècle ne peuvent être comparées à celles du XIXe. Certes. Mais, je ne peux pas oublier le XIXe siècle, je ne peux pas oublier ce que le bourgeois faisait aux ouvriers et ce qu’il fait encore un peu loin d’ici en Chine ou ailleurs. Et, il continuera tant qu’il aura besoin d’ouvriers. Et si la Chine aujourd’hui est communiste comment prétendre donner de l’espoir aux prolétaires que nous sommes tous à 99% avec ce beau mot, malheureusement noirci et sali, de communisme. Oui, renier le monde industriel, c’est renier la théorie révolutionnaire, la seule qui tienne vraiment la route. C’est renier le fait qu’il fallait en passer par là malheureusement, selon Marx. C’est renier le sens de l’Histoire. Je sais aussi que l’homme ne peut oublier ce qu’il a créé. Alors, il s’agirait simplement que le « progrès » soit entre de bonnes mains. Il faut croire à l’Histoire comme croit celui qui a la foi en Dieu. Mais, le vrai croyant est souvent accablé par le doute. Je rêve du communisme primitif mais je ne voudrais pas vivre dans une caverne évidemment. Mais, où trouver une dystopie joyeuse ? C’est une contradiction dans les termes. L’homme est un technicien, la main fait l’Homme. L’Homme devient Homme grâce à sa main. Mais, il l’a oublié. Et il est aujourd’hui l’esclave de l’outil que sa main a créée. Comment pourrait-il reprendre les choses en mains ? Je sombre dans l’aporie. On ne peut tout détruire même en détruisant tout et il faudrait tout détruire. Détruire ce qui n’a aucune chance de perdurer. Ça, fermement, je le crois.

Merci pour cette nouvelle pépite 😁👍
Bonne journée Philippe
Et « si je suis désespérée , que voulez vous que j y fasse « …